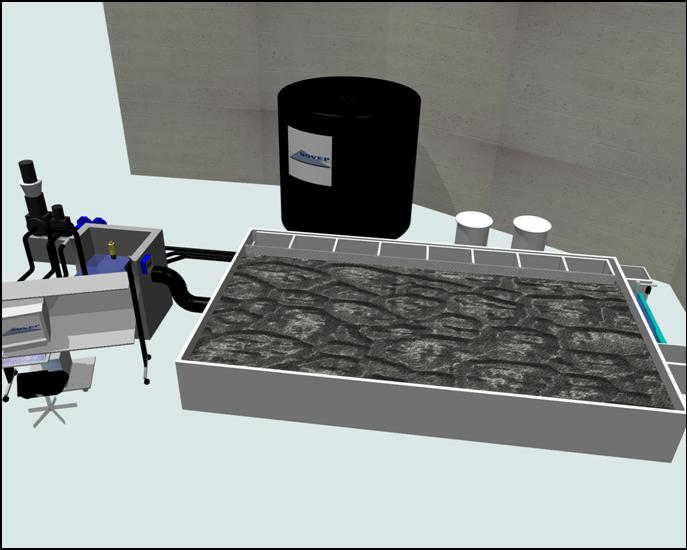
INTRODUCTION
La gestion des eaux pluviales pour beaucoup de collectivités
pose le problème de saturation du réseau et des stations
d’épurations entraînant inondations et pollutions non
contrôlées.
Les techniques alternatives à l’assainissement pluvial
classique ont pour fonction de déconcentrer les flux des eaux
pluviales en redonnant aux surfaces urbaines sur les lesquelles
se produit le ruissellement, un rôle régulateur, fondé sur la
notion de stockage pour régler les débits et limiter la
pollution due aux surverses d’eaux pluviales à l’aval.
Même si les techniques alternatives permettent d’écrêter
les débits pluviaux en amont des réseaux d’assainissement,
des points restent encore à éclaircir tels que la durabilité
de ces techniques et l’optimisation de la coupure de la
pollution.
En particulier dans le cas où le corps d’une voirie est
utilisé comme stockage avant infiltration des eaux pluviales,
l’injection de celles-ci doit être précédée d’un
traitement par décantation et d’un système de rétention
des flottants et des substances indésirables.
Pour cela la société douaisienne CONSTRU et le Syndicat
Intercommunal d’Assainissement de la région de Douai (SIADO)
ont développé le concept du filtre et des bouches
d’injection (Cf. fiche
Par
le biais d’une maquette réalisée grâce à un partenariat
entre le SIADO, l’
Le but général de cette expérimentation est de connaître,
d’une part, l’efficacité d’un filtre permettant
l’interception de la pollution au niveau de la bouche
d’injection et, d’autre part, la capacité de coupure
de la pollution par la structure stockante elle-même. Au final,
les résultats nous permettront d’estimer la diminution
totale de la charge polluante à travers l’ouvrage étudié.
Ces expériences permettront aussi d’observer le colmatage
dans la chaussée à structure réservoir et ainsi
d’évaluer la durée de service de la structure.
EXPERIMENTATION
ET RESULTATS
Dans le domaine du
traitement des eaux pluviales, tous les spécialistes se
rejoignent pour considérer que la pollution est fortement liée
aux particules et que le bon piégeage de ces particules peut-être
un résultat satisfaisant mais parfois difficile à atteindre. Le
principe de cette étude consiste à fournir des connaissances
afin d’optimiser les techniques à mettre en œuvre et
de définir des solutions cohérentes.
Si
le fonctionnement hydraulique des chaussées à structure
réservoir semble être maîtrisé, plusieurs paramètres restent
à déterminer sur l’optimisation de la capture de la
pollution. C’est dans cette optique que nous allons tester
un filtre incorporé dans la bouche d’injection et réaliser
un certain nombre d’expériences à l’aide d’une
maquette montée en laboratoire.
I. Projet :
A l’aide de cette maquette, un plan d’expériences
vise les objectifs suivants :
-
Déterminer la diminution de la charge polluante à
l’exutoire de la chaussée réservoir.
-
Déterminer le pouvoir de coupure du filtre dans la bouche
d’injection.
-
Suivre l’évolution de la pollution particulaire à travers
la structure et le colmatage de celle-ci.
I.1- Description
de la maquette
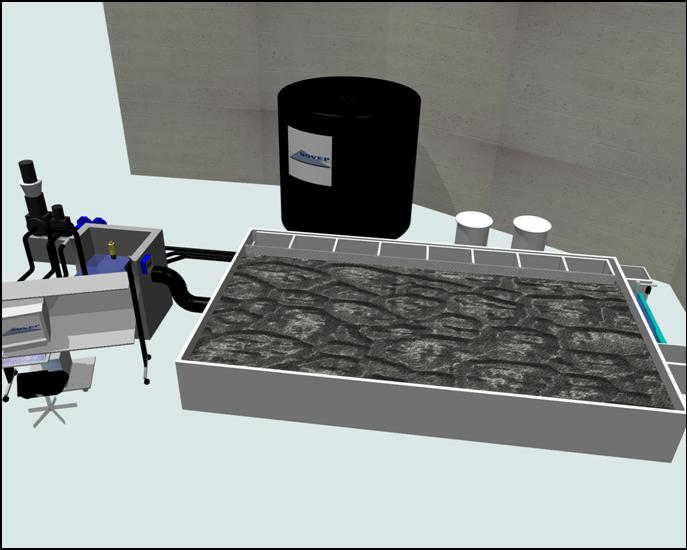
|
|||||||||||||||
 |
|||||||||||||||
 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
 |
|||||||||||||||
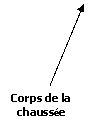 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
La maquette permet se simuler des eaux pluviales ruisselant sur
une surface imperméable de 250 m² grâce à une cuve de
stockage cylindrique d’une capacité de
Ils évoluent dans le corps de la chaussée
(grave naturelle de granulométrie 20/80) grâce au drain situé
en fond de structure qui le relie à la bouche d’injection
pour enfin sortir par le biais d’un canal de "Venturi".
L’unité de filtration est, quant à elle, composée d’un porte filtre en pvc gris, d’une cartouche filtre, de deux brides alu, de quatre chenilles nylon avec vis et d’un joint d’étanchéité

Photo 1 : Bouche d’injection connectée à une
structure réservoir
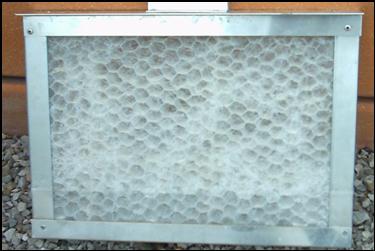 |
Photo 2 : Filtre
– vue de face
 |
|||
 |
|||
Photo 3 : Filtre
et porte filtre – vue de profil
Pour la
réalisation des expériences, une fine industrielle de diamètre
médian D50 35 µm et de D10 99 µm approchant de très près ces
caractéristiques est utilisée.
Voir la fiche de
granulométrie de la fine utilisée
CONCLUSIONS ET
PERSPECTIVES
L’objet de
l’étude porte sur une fraction fine (inférieure à 200 µm)
des matières en suspension (MES), les MES de taille supérieure
étant considérées toutes arrêtées par le filtre.
Les expériences
ont démontré une efficacité de coupure du filtre de
l’ordre de 15 à 20 % sur la granulométrie étudiée. Elles
ont en outre mis en valeur l’absence totale de problèmes
hydrauliques. La densité d’une bouche d’injection pour
250 m² de voirie apparaît de fait adaptée (confirmation de
terrain à l’appui). Soit la même densité que pour les
bouches d’égout classiques.
Le dépôt de fines se
fait principalement à deux niveaux :
- Dans la bouche d’injection.
-
Dans le corps de la chaussée, avec un phénomène de relargage
pour les forts débits (progression vers l’aval dans toute
la structure).
Le dépôt de fines important dans la partie aval de la chaussée
réservoir pousse à émettre l’hypothèse que les fines
migrent dans la chaussée de l’amont vers l’aval ce qui
peut-être à l’origine de colmatages ponctuels au droit
d’ouvrages singuliers. Le colmatage global de la chaussée (plus
de 1000 ans !) n’est quant à lui pas un problème
au regard de la durée de vie moyenne des chaussées (50 ans).
Les expériences
menées amènent à poser de nouvelles questions :
-
Le risque de colmatage ponctuel est-il réel ?
-
Dans le cas d’une chaussée avec infiltration, existe-t-il
un risque de diminution des capacités d’infiltration du
fond de chaussée ?
-
Comment réagit le filtre s’il y a création d’un film
biologique ? Y’a-t-il augmentation du pouvoir de
coupure ?
-
Est-il possible de recourir à d’autres matériaux à
pouvoir de coupure plus performant pour le filtre vu la marge
hydraulique dont nous disposons ?
Une poursuite de
l’étude menée ici pendant deux ans répondrait à
ces questions grâce au couplage avec une étude de terrain pour
intégrer la pollution réelle des eaux pluviales dans les
simulations.
Les conclusions ci-dessus
permettent d’envisager la généralisation du système de
filtre à poser dans les bouches d’égouts sur les réseaux
pluviaux de sorte à améliorer la qualité des rejets au Milieu
Naturel sans investissement lourds mais surtout sans surcoût
d’exploitation (en effet, une bouche d’égout avec
filtre s’entretient deux fois par an comme une bouche
d’égout classique et avec les mêmes moyens).